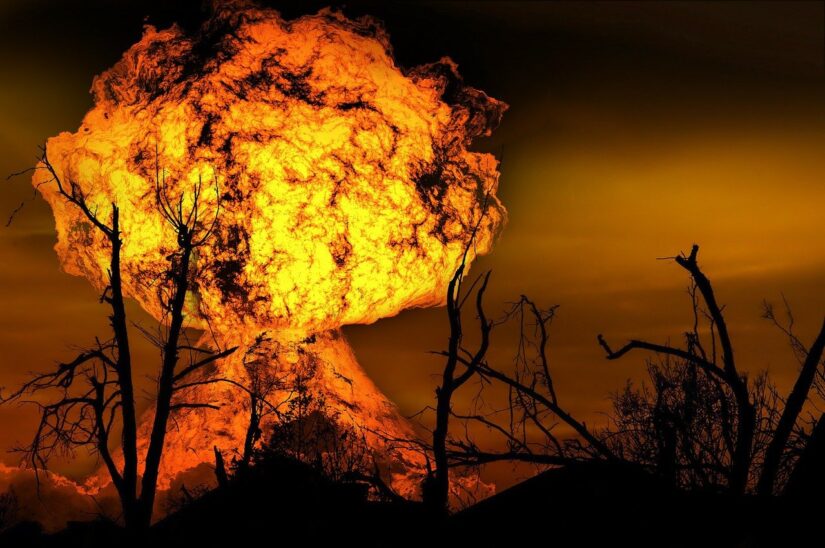EnvironnementSociété
Réunir les enjeux de climat et de biodiversité

[tribune] L’automne est traditionnellement marqué par les grandes conférences internationales sur les enjeux environnementaux. La COP30 sur le climat se tiendra le mois prochain à Belém, au Brésil et en 2026, la COP17 sur la biodiversité aura lieu en Arménie. Deux dates qui illustrent un paradoxe fondamental dans la gouvernance environnementale mondiale : la séparation persistante entre des processus qui visent pourtant à résoudre des crises intrinsèquement liées.
L’origine de cette dichotomie remonte au Sommet de la Terre de Rio en 1992, où la communauté internationale a établi des cadres légaux distincts pour le climat (la CCNUCC, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) et la biodiversité (la CDB, Convention sur la diversité biologique).
Une gouvernance fragmentée face à des enjeux systémiques
 Depuis, ces deux processus évoluent parallèlement, avec des objectifs, des financements et des négociateurs différents. La COP Climat se concentre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tandis que la COP Biodiversité vise la conservation des écosystèmes. Ces thématiques ont cependant la même origine : les activités humaines sur notre environnement. Elles se croisent et sont interdépendantes : la crise climatique exacerbe l’érosion de la biodiversité, tandis que la perte de biodiversité limite notre résilience face aux bouleversements climatiques (entre autres).
Depuis, ces deux processus évoluent parallèlement, avec des objectifs, des financements et des négociateurs différents. La COP Climat se concentre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tandis que la COP Biodiversité vise la conservation des écosystèmes. Ces thématiques ont cependant la même origine : les activités humaines sur notre environnement. Elles se croisent et sont interdépendantes : la crise climatique exacerbe l’érosion de la biodiversité, tandis que la perte de biodiversité limite notre résilience face aux bouleversements climatiques (entre autres).
Pourtant, dès 2004, les discussions sur l’adaptation des écosystèmes au changement climatique ont posé les bases des « solutions fondées sur la nature », les NBS), aujourd’hui essentielles pour répondre aux multicrises environnementales du XXIe siècle. Ces échanges ont également mis en lumière le rôle crucial des écosystèmes, tels que les forêts, les océans et les zones humides, dans la séquestration du carbone atmosphérique.
Ce n’est toutefois qu’en 2015, avec l’Accord de Paris, que la conservation et la restauration de la biodiversité ont été reconnues comme des éléments clés pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre et adapter les sociétés aux impacts du changement climatique.
Sur le terrain, cette interdépendance est évidente. L’Amazonie en est le plus emblématique exemple, étant à la fois un puits de carbone essentiel et un hotspot de biodiversité. Sa destruction affecte non seulement le climat mondial, mais aussi la sécurité alimentaire, la santé humaine et l’équilibre écologique global. Les impacts cumulatifs de ces crises montrent que leur gestion séparée est non seulement inefficace, mais peut aussi conduire à des maladaptations.
Les solutions pathogènes ou maladaptations des politiques sectorielles
Le manque de vision globale conduit à des politiques fragmentées qui ignorent les synergies possibles entre les deux crises. Qui sur le terrain peuvent se traduire par des solutions qui peuvent s’avérer littéralement écocide et/ou pathogène, telles que :
⇒ Les subventions pour les biocarburants, censées réduire les émissions de carbone, ont favorisé la déforestation et l’usage intensif de pesticides. Comme ce fut le cas en Indonésie, où la culture de l’huile de palme (entre autres à destination de biodiesel) a poussé la faune sauvage à entrer en contact avec les élevages de poulet domestique… favorisant ainsi l’émergence de la grippe aviaire.
⇒ Les projets de compensation carbone via la plantation d’arbres en monoculture remplacent souvent des écosystèmes naturels plus complexes, comme des prairies ou des zones humides. Ces plantations appauvrissent la biodiversité, épuisent les sols, et augmentent les risques incendies (2022 en Gironde). Cela perturbe également la faune locale qui ne peut s’adapter aux plantations, tout en effaçant le rôle de puits de carbone de l’écosystème préexistant.
L’urgence d’une approche transversale et globale
La séparation des mandats et des cadres législatifs limite la capacité des COP à répondre aux crises environnementales de manière cohérente. Alors que les thématiques abordées (santé, alimentation, droits humains, éducation, peuple autochtone, etc.) se recoupent souvent, les COP continuent d’opérer en silos, épuisant négociateurs et observateurs. Une verticalité qui entrave autant l’efficacité des possibles solutions, que la crédibilité des institutions internationales.
Cette approche sectorielle cloisonnée implique des délégations distinctes ; les négociateurs du climat proviennent principalement des secteurs de l’énergie et de l’économie, tandis que ceux engagés dans les discussions sur la biodiversité représentent majoritairement les domaines de l’environnement et de l’agriculture ; ce qui complexifie l’élaboration de politiques intégrées et cohérentes.
Une fracture que l’on retrouve au niveau des financements, où se développe une concurrence pour des ressources financières déjà difficiles à mobiliser. Récemment, la COP29 sur le climat s’est conclue par un accord financier jugé décevant (seulement 30 % du montant escompté) tandis que la COP16 dédiée à la biodiversité n’a même pas eu le temps de traiter la question pourtant cruciale du financement dédié à la préservation des écosystèmes.
Une verticalité qui invisibilise les liens qui unissent les limites planétaires
La crise climatique occupe (relativement) les médias depuis quinze ans et nous en sommes toujours à tenter de dérouler le premier chapitre. Certains journalistes s’étonnent encore du réchauffement climatique devant un épisode neigeux… Dans un tel contexte, comment aborder les neuf limites planétaires, dont sept d’entre elles sont déjà franchies ?
Parce que, malheureusement, il n’y a pas seulement deux crises environnementales majeures à gérer, mais une bonne dizaine. Toutes liées et interdépendantes.
En 2024, la COP29 terminée, le monde est prié de se réunir en Corée du Sud, à Busan, pour finaliser un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique qui fait partie des sept limites planétaires déjà dépassées : « Introduction d’entités nouvelles dans la biosphère ».
Le plastique… un sujet hautement climatique et environnemental. Sa légèreté et sa robustesse en ont fait une solution prisée de la transition écologique. Cependant sa résistance est également sa faiblesse : sur les 9000 millions de tonnes de plastique produites depuis 1950, 7000 millions sont dorénavant des déchets, polluant les sols, les océans et même nos corps, avec des traces retrouvées jusque dans le liquide amniotique des femmes enceintes.
Fabriquée à partir de combustibles fossiles, sa production annuelle de 430 millions de tonnes nécessite 215 millions de barils de pétrole, avec une empreinte carbone largement ignorée. Et c’est cette particularité qui a dernièrement empêché l’obtention d’un traitant contraignant autour de la production plastique aussi bien à Busan, qu’à Genève en 2025. Notamment du fait de l’opposition des pays producteurs de pétrole qui voient dans le plastique un « nouveau » débouché pour survivre à la transition énergétique.
L’échec de ces négociations nous permet de nous diriger vers les 700 millions de tonnes de plastique produite annuellement d’ici la fin de la décennie…

Vers une gouvernance adaptée aux enjeux du XXIe siècle
Des négociations qui auraient été pertinentes de coordonner aux précédentes, mais également aux six autres thématiques que sont les négociations autour du cycle de l’azote et le phosphore, le changement d’usage des sols, l’utilisation de l’eau douce, l’acidification des océans, l’appauvrissement de la couche d’ozone et l’augmentation de la présence d’aérosols dans l’atmosphère.
La convergence de toutes ces limites planétaires nous confronte à la frontière ultime : celle de notre humanité, incarnée dans nos limites sanitaires.
Bien que nous disposions d’une certaine capacité d’adaptation, notre physiologie reste régie par des barrières infranchissables. Elle a été mise à l’épreuve par un virus face auquel notre système immunitaire était incompétent. Elle est tout aussi démunie face à la pollution plastique que nous ingérons quotidiennement, aux additifs introduits par l’agro-industrie pour pallier à la menace de l’insécurité alimentaire, ou encore aux particules fines que nous respirons à chaque instant. Et que dire de cette chaleur humide qui, dans certaines conditions extrêmes, nous laisse seulement six heures avant que notre organisme ne succombe ?
L’enjeu est énorme et terriblement multisectoriel, transversal et global. Pour tenter de limiter l’impact des activités humaines sur notre environnement, nous avons besoin d’utiliser les mêmes outils : la transversalité, la coopération et la coordination. Et ne plus nous cacher derrière un cadre législatif obsolète hérité du XXe siècle, véritable handicap pour faire face aux limites planétaires.
Le précédent de la COVID-19
Devant le bouclier de résistances, il nous faut pourtant nous réinventer si nous ne voulons pas réitérer l’erreur de réfléchir une « limite » à la fois, en négligeant les autres. Une imprudence qui nous a déjà frappés de plein fouet avec la pandémie de COVID-19, véritable point de bascule marquant le début du XXIe siècle. Cette pandémie illustre cruellement l’interconnexion des enjeux : la mondialisation des flux de personnes et des marchandises a permis à un virus aéroporté de se propager à une vitesse inédite, révélant les fragilités d’un monde hyperconnecté et incapable d’anticiper les conséquences de ses propres dynamiques globales…
Aujourd’hui, il est impératif de secouer le système en profondeur pour amorcer une transformation radicale, capable de réinventer nos modèles tout en gardant à l’esprit un objectif fondamental : réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement et, par extension, sur notre santé. Les défis que posent le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution ne peuvent plus être abordés de manière fragmentée. Une approche systémique et transversale est indispensable pour réconcilier nos aspirations de développement avec les limites planétaires.
♦ (re)lire : L’art rend visible l’invisible, notamment le changement climatique
Un cadre juridique global et un financement unique
La création d’un cadre juridique global, intégrant à la fois les enjeux climatiques et environnementaux, apparaît comme une priorité. Un cadre dépassant les cloisonnements actuels entre les conventions internationales (climat, biodiversité, pollution) en adoptant une approche holistique.
En parallèle, la création d’un fonds unique capable de financer des projets transversaux adressant simultanément plusieurs problématiques devient impératif. Un fond pour soutenir des initiatives combinant restauration des écosystèmes, réduction des émissions de gaz à effet de serre, et amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Comme la restauration des zones humides, qui agissent comme puits de carbone, régulateurs hydriques et habitats pour la biodiversité ; la promotion de l’agroécologie, réduisant les impacts climatiques et renforçant la sécurité alimentaire ou la mise en place des infrastructures vertes, pour atténuer les vagues de chaleur urbaines tout en capturant les polluants atmosphériques.
L’intérêt commun mieux que le conflit d’intérêt
D’autre part, en centralisant les financements et en soutenant des projets aux bénéfices multiples, ce fonds unique pourrait également réduire les conflits d’intérêts entre les différents secteurs et encourager une coopération internationale renforcée.
Il est clair que cette transformation nécessite un changement de paradigme. Rassembler les efforts autour de cadres unifiés et d’outils communs, tout en garantissant des financements efficaces, est la clé pour relever les défis environnementaux et sanitaires de notre époque. Cette approche systémique est non seulement une nécessité urgente, mais aussi une opportunité de construire un avenir plus équitable et durable, où santé humaine et environnement étroitement lié se retrouvent autour du concept « One Health » : une santé environnementale protégée pour une santé humaine préservée. ♦
*Cet article a été originellement publié sur le site de l’IRIS le 10 décembre 2024. À retrouver ici. Créé en 1991, l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques.
**La Dr Anne Sénéquier est chercheuse et co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale de l’IRIS, spécialisée sur les questions santé et environnement. Elle est titulaire d’un doctorat en psychiatrie, suivi d’une spécialisation en pédopsychiatrie. Son cursus est doublé d’un master de « santé publique – épidémiologie » et d’un master « Action humanitaire : enjeux stratégiques et gestion de projet » au sein d’IRIS Sup’ où elle enseigne. Elle est également chargée de cours à l’Université catholique de Lille sur le master « environnement et transition ».